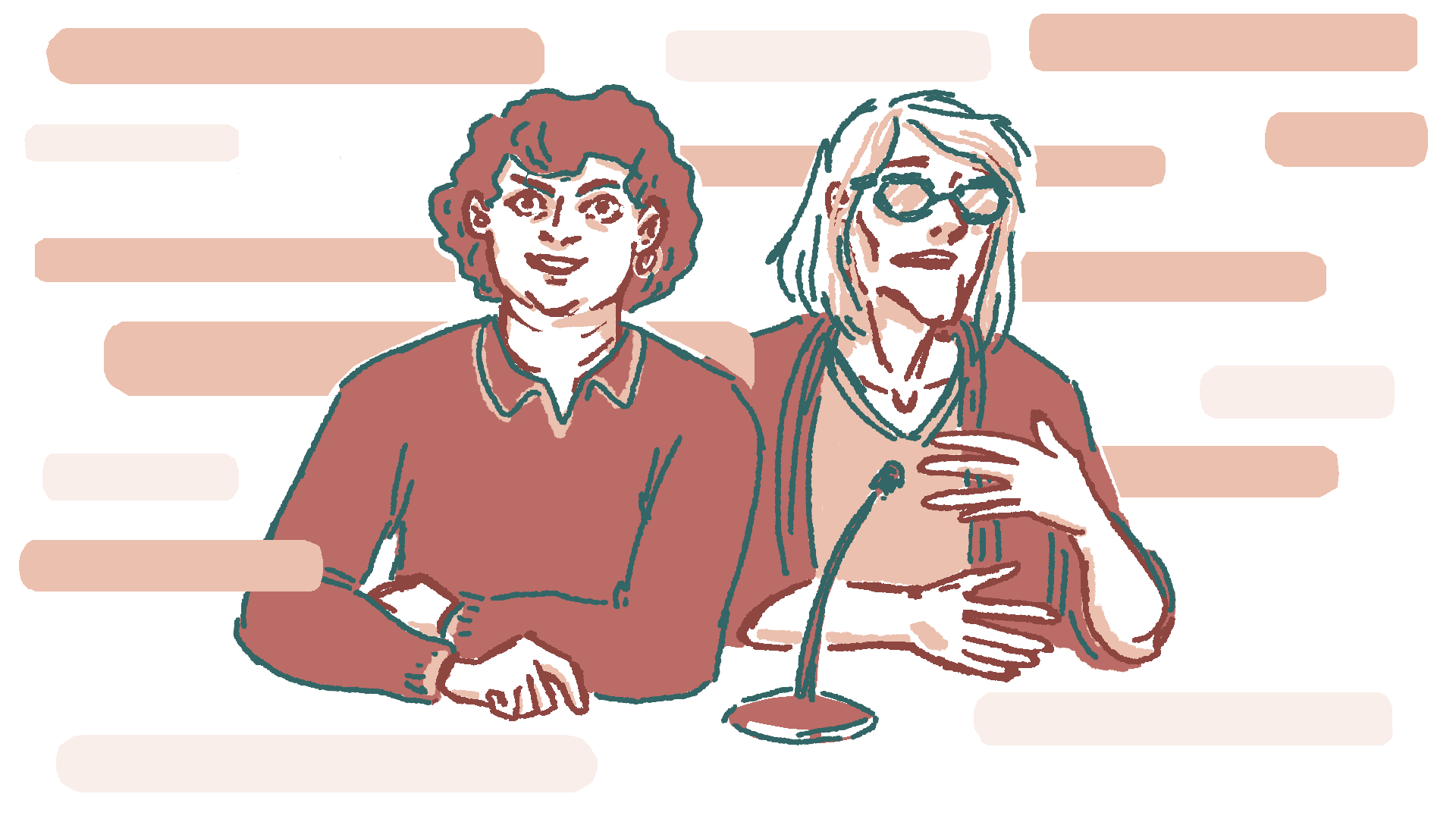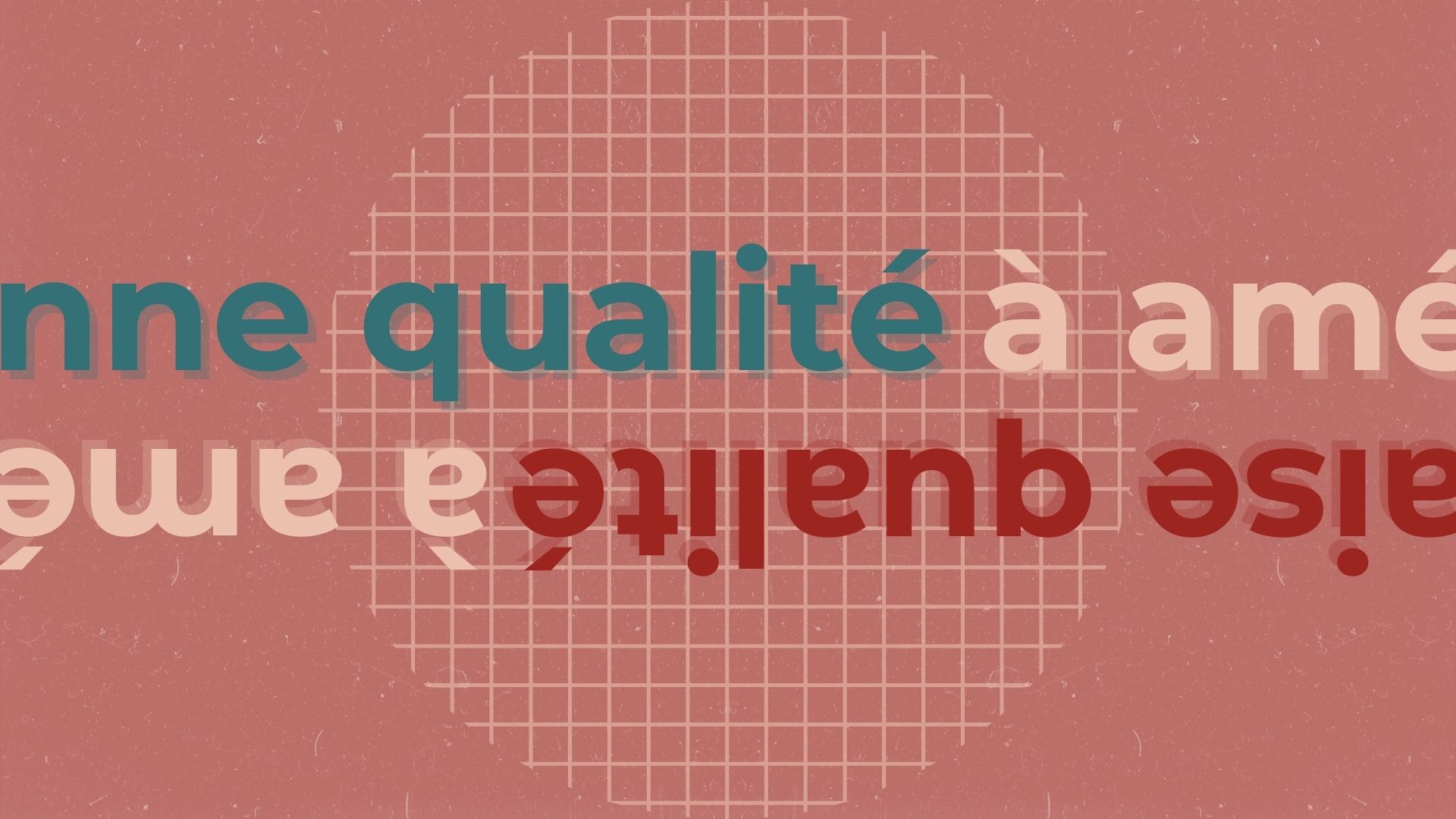Face à l’emballement médiatique récurrent autour des transidentités, il est parfois difficile de prendre du recul sur la pratique journalistique. Comment évolue le traitement médiatique des transidentités ? Pourquoi voit-on autant de tribunes, et aussi peu de portraits de personnes trans d’âge mûr ? Pourquoi certaines idées reçues sur les personnes trans perdurent-elles ? Les transidentités seraient-elles « anti-universalistes » ? Entretien croisé avec Karine Espineira, sociologue des médias et co-autrice avec Maud-Yeuse Thomas de Transidentités et transitudes, se défaire des idées reçues et Alex M. Mahoudeau, spécialiste de sciences politiques et autrice de La Panique woke.
Quelle évolution observez-vous depuis 10 ans dans le traitement médiatique des transidentités ? Pensez-vous qu’il s’est amélioré ?
Karine Espineira : Jusqu’à il y a très peu de temps, il y avait une lente évolution, avec ses flux et reflux, une série de bons documentaires puis un débat mauvais par exemple. Ça se passait bien de façon globale, mais depuis deux ans avec les apparitions médiatiques de personnes portant une rhétorique anti-trans, ce n’est plus le cas. Leurs discours se diffusent dans les médias. J’ai vraiment l’impression de revoir les émissions que je voyais dans les années 1990.
Quand, au milieu des années 2000, les documentaires ont accompagné les changements générationnels, on voyait plus de portraits croisés, avec notamment davantage de personnes jeunes et transmasculines. Avant ça, on avait tendance à montrer surtout des aînés et très majoritairement des femmes trans, qui témoignaient face à un psychiatre. On assiste justement au retour de cette psychiatrisation et cette pathologisation des transidentités, avec des discours à contre-courant de toutes les évolutions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la Classification internationale des maladies (CIM) et des nomenclatures nationales et internationales. Celles-ci ont mis 20-30 ans à évoluer, et nous, on est revenu à la pathologisation des personnes trans en deux ans.
Pourquoi deux ans ?
K.E. : C’est plus exactement fin 2019. Cela a démarré avec une vague de tribunes anti-trans dans Marianne, Le Figaro, Valeurs Actuelles, etc. Aujourd’hui cette vague arrive jusqu’à Libération. Quand on y voit le portrait glamourisé d’une personne qui a été contre le PACS et le mariage pour tous [la psychanalyste Caroline Eliacheff, ndlr], on a envie de pleurer.
Il y a eu un changement avec la médiatisation des enfants et ados trans, à partir du moment où le thème a été repris par les personnes tenant des rhétoriques anti-trans. On ne parle quasiment plus de personnes trans comme moi. J’ai 55 ans, et c’est à six ans que j’ai compris. Les adultes trans d’aujourd’hui ont été des enfants un jour, mais on occulte cette parole dans les rhétoriques actuelles.
« Vous avez rarement le portrait de Roger, 45 ans, boulanger. Les portraits sont toujours passés à la moulinette du sensationnalisme médiatique, ce qui favorise les paniques morales. »
– Alex M. Mahoudeau
Dans les articles que nous avons recensés, on voit des sujets plus incarnés, avec un vocabulaire plus précis, et des angles plus divers qu’il y a quatre ou cinq ans. Si un certain nombre de journalistes traitent des transidentités de manière éthique et honnête journalistiquement, peut-on pour autant considérer que c’est devenu un sujet comme un autre, un peu installé ?
K.E. : Je suis d’accord avec ce constat. Quand, il y a moins de dix ans, j’avais répondu en tant que sociologue à un entretien, je m’étais retrouvée présentée comme « Karine, transsexuelle ». Ça n’arrive plus. Aujourd’hui en interview on ne m’amène plus sur le terrain de la vie privée. À la limite c’est moi qui l’amène pour parler des réalités trans, mais j’en suis maître.
Il y a eu de très beaux articles, mais depuis deux ou trois ans ce travail est contrebalancé par des tribunes. Et le discours porté par les tribunes réactionnaires revient maintenant dans différents médias. Les discours sont très tranchés, avec deux pôles qui s’éloignent de plus en plus.
Alex M. Mahoudeau : Il y a quelques années, il y a eu tout un cycle médiatique autour d’une gamine trans, avec une idée de révolution du genre, de phénomène de bascule… Selon les publications, vous allez être soit dans la crise de l’identité, le fléau qui va détruire l’humanité, soit dans les incroyables explorateurs du genre, une sorte de Star Trek de la sexualité. Quel que soit l’angle, c’est toujours sensationnaliste, en « mal » ou en « bien ». Vous avez rarement le portrait de Roger, 45 ans qui a transitionné dans les années 1980, travaille comme boulanger dans son village. Les portraits sont toujours passés à la moulinette du sensationnalisme médiatique, ce qui favorise les paniques morales.
K.E. : Je pense que la gamine à qui tu fais allusion est Jazz Jennings. En 2007, alors qu’elle doit avoir six ou sept ans, elle est interviewée par Barbara Walters, une pointure qui interroge généralement des présidents. Cette enfant révèle une maturité incroyable, ce qui fait parler. On prend la mesure qu’on a toujours vu, médiatisé et accompagné des adultes trans. On voit des demandes qu’on ne voyait pas avant, bien qu’elles aient toujours existé. Pour ma génération et bien d’autres avant, elles ne pouvaient pas s’exprimer. L’OMS prend acte en 2013, revoyant les nomenclatures pour l’accompagnement des enfants.
L’autre évolution, c’est qu’à partir de 2014, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Espagne, naît un mouvement qui commence à créer cette panique morale autour des transitions des plus jeunes. Il s’est formé des coalitions entre catholiques traditionalistes ou d’extrême-droite avec tout un tas de gens qu’on ne verrait normalement pas bosser ensemble. Là, ils arrivent à s’entendre.
Cette médiatisation n’a pas été négative en soi. Elle a entraîné la création de kits pédagogiques, des vidéos à l’intention du personnel médical, des travailleurs sociaux et des familles. On aurait pu se réjouir de ces évolutions, mais ça nous a aussi conduit à une vague réactionnaire.
A.M.M. : Dans le livre controversé de Caroline Eliacheff et Céline Masson, le phénomène des transitions notamment chez les mineur·e·s est présenté comme ayant quasiment commencé avec le documentaire [de Sébastien Lifshitz sorti en 2020, ndlr] Petite Fille. En entretien, elles y reviennent toujours, comme si c’était un événement fondateur plutôt que la présentation au public d’un phénomène connu de longue date par les spécialistes, y compris ceux auxquelles elles se réfèrent elles-mêmes. Cela me semble être un dispositif narratif de dramatisation. Cet outil s’accompagne d’ailleurs d’autre chose sur le plan du traitement médiatique : ce serait un phénomène venant principalement des États-Unis. On choisit d’effacer les « grandes figures » trans de l’Histoire française.
« Les gens sont perdus face aux socialités et cultures des personnes trans. Or il est plus facile de rester sur ses positions, sur ce qui ne nous bouscule pas. C’est le socle de toutes les idées reçues. »
Karine Espineira
Karine Espineira, vous avez coécrit avec Maud-Yeuse Thomas Transidentités et transitude, un ouvrage qui déconstruit les idées reçues sur les transidentités, que l’on retrouve notamment dans des tribunes, articles et ouvrages hostiles aux personnes trans. Quelles sont les idées reçues qui reviennent le plus souvent dans les médias et sur quoi reposent-elles ?
K.E. : J’ai presque envie de dire toutes. Ces idées s’expriment à travers des normes. La finalité, c’est l’idée que nous sommes un phénomène, voire une illusion. L’idée qu’on n’existe pas ou qu’on a de fausses revendications, et qu’on a trouvé des réponses plus ou moins folles à une fausse question. C’est ici que l’on peut mobiliser les concepts de cisgenrisme et de cisnormativité : c’est l’idée que toutes les femelles deviennent des filles puis des femmes, et que tous les mâles deviennent des garçons puis des hommes. Bref, les personnes trans, ça ne peut pas exister si on suit cette idée. C’est comme si on disait aujourd’hui que tous les hommes et les femmes deviennent hétérosexuels. Ça ne marche pas comme ça et il en est de même pour la question du genre. On ne lit les personnes trans qu’à partir des termes de la binarité. On nous applique ses idées, sa socialité mais aussi les rapports homme-femme.
Les gens sont perdus face à nos socialités et cultures. Or il est plus facile de rester sur ses positions, sur ce qui ne nous bouscule pas. C’est le socle de toutes les idées reçues. Parce que ces idées reçues sont aussi un ensemble de refuges. On est tellement bien dans son monde que l’on ne veut surtout pas rentrer à certains endroits car « on ne sait jamais ». On va défaire la binarité, c’est dangereux. Et ensuite, on va toucher à la sexualité, et puis là, on va finalement toucher à une socialité qui concerne tout le monde et qui dépasse les rapports homme-femme. Et la binarité, c’est dans toute notre culture, dans ce qu’on apprend, ce qu’on illustre. On la respire. Il y a des gens qui ne veulent pas qu’on leur fasse respirer autre chose que leur propre oxygène.
Les personnes trans sont souvent, notamment dans les tribunes, utilisées comme substitut, personnification ou produit du « wokisme ». Qu’est-ce que cela révèle?
A.M.M. : Cela révèle qu’ils n’y connaissent rien. Quand on ne sait pas comment commencer une dissert’ de philo, on commence par « de tout temps les Hommes… ». Là c’est la même chose : quand on ne sait pas expliquer un phénomène sociologique, c’est le wokisme.
Il y a eu une convergence affinitaire. Tout semble indiquer que le groupe des intellectuels conservateurs est un mouvement social qui agit par des manifestations de papier, médiatiques, dont le principal moyen d’action est la tribune. Ce mouvement social entretient ses rapports sociaux par de l’entraide, de la sociabilité. Cette dernière passe par le fait de signer les tribunes des uns et des autres. Ce sont ces méthodes qu’utilise l’Observatoire de la petite sirène, ainsi que des membres de la Manif pour tous. Ces gens-là ont tissé des liens avec les différents groupes qui s’agitent sur le wokisme…
Toujours dans les tribunes, on voit régulièrement des personnes justifier leurs positions transphobes par leur attachement à l’universalisme, pilier central de nos valeurs républicaines. Qu’est-ce qui est entendu derrière cette opposition entre transidentité et universalisme ?
A.M.M. : Un dévoiement du sens du mot « universalisme » s’est produit dans les années 2010. Ça a été documenté par des universitaires comme Mame-Fatou Niang et Marwan Mohammed. Le sens du mot « universalisme » devient identitaire dans la bouche d’un certain nombre d’intellectuels. Ce mot ne fait alors plus référence à une doctrine, sinon il serait trans-inclusif. Car l’universalisme est censé se baser sur l’idée que, indépendamment du fait que je ne connais pas les détails de la vie des autres, je suis humain comme eux. On est donc capable de se comprendre et de se battre pour les droits les uns des autres. L’inverse serait de dire que l’Humanité appartient à un groupe, et que les autres en sortent. Le terme adéquat est « identitaire ».
Leur universalisme est un identitarisme. C’est l’identification d’un groupe de personnes intégrées à défendre, qui ont raison quoiqu’elles fassent. Et à l’extérieur de ce groupe, on est dans le faux, dans le mensonge et la barbarie. Cela se retrouve très bien dans les discours de Caroline Eliacheff et Céline Masson. À plusieurs reprises dans leur livre, elles présentent leur travail comme une entreprise de défense de la civilisation contre la folie. Leur devoir est de protéger la société contre les fous. La transidentité est présentée comme « une mystification collective » caractérisée par « une haine de l’humain », elles reprochent d’ailleurs aux personnes trans et LGBT, mais aussi aux personnes parlant de racisme, de « segmenter la société ». Un reproche qu’elles ne font jamais aux transphobes, ou aux racistes. Tout ça est l’inverse de l’universalisme.
« Le monde médiatique est structuré autour de la nécessité de produire de l’information à la chaîne. On n’a pas le temps de vérifier, et les faiseurs de tribunes ne sont pas soumis à la déontologie. »
Alex M. Mahoudeau
K.E. : Ces discours « anti » vont, comme on le disait, à contre-courant de la dépathologisation des identités trans. Cela donne à réfléchir : il s’agit pour ces « universalistes » de nous ramener à une période où nous n’avions pas de droits.
Un bon nombre de publications évoquent une mise en danger des enfants par les personnes trans, faisant régulièrement directement ou indirectement référence à la ROGD, une théorie pseudoscientifique sur une soi-disant « contagion sociale ». Comment une théorie amplement débunkée par les chercheuses et chercheurs peut-elle encore être référencée sérieusement dans les médias ?
A.M.M. : Pour comprendre les tenants et aboutissants de l’étude de Lisa Littmann [sur la ROGD, ndlr], il faut avoir un peu de méthodologie des sciences sociales, et il faut avoir envie de la mobiliser. Ce n’est pas que les journalistes soient mauvais·e·s ou mal formé·e·s, c’est que le journalisme se fait à un rythme qui ne permet pas d’aller dans ce type de débat.
Les individus qui citent ce genre d’études ne sont de toute façon pas des journalistes. Ce sont des essayistes, éditorialistes ou des intellectuels faiseurs d’opinion, donc des gens qui ne sont pas tenus par la rigueur journalistique. Non seulement cette théorie-là continue d’exister après avoir été rejetée, mais d’autres théories tout aussi pseudoscientifiques se font entendre : on peut citer la distinction pseudoscientifique entre « transsexuelles homosexuelles et transsexuelles autogynéphiles », par exemple. Une étude très fréquemment sortie montre que 80% des personnes ont détransitionné… Mais le panel de l’étude n’était pas constitué de personnes trans. Méthodologiquement ça tient pas.
Au bout, vous avez un monde médiatique structuré autour de la nécessité de produire de l’information à la chaîne. On n’a pas le temps de vérifier, et les faiseurs de tribunes ne sont pas soumis à la déontologie. Des médias se structurent même autour de ça : prenez le FigaroVox par exemple. Au prétexte de faire une interview, on peut laisser des propagandistes dire n’importe quoi.
K.E. : J’ajouterai qu’il n’y a jamais de travail de terrain dans ces études. Et au niveau des médias, ce n’est jamais interrogé. Littmann devient « spécialiste » des questions de genre en un an, annonce tout un tas d’articles. Elle entretient une ignorance totale. Le ROGD est très efficace, dans le sens où c’est du prêt à l’emploi. C’est beaucoup plus facile que de lire ce qu’on écrit. C’est comme si on opposait quelqu’un qui est très doué sur un tweet, capable d’envoyer une idée en 240 caractères, à une réalité qui nécessite dix pages pour être décrite.
A.M.M. : Mon intuition c’est qu’au fond, la transition n’est pas un sujet très intéressant. Une fois qu’on a passé le côté un peu sensationnel de « Oh la la ! Et alors ? Les opérations ? Et alors ? », c’est un sujet d’une troublante banalité. Quand on lit les travaux du sociologue Emmanuel Beaubatie, par exemple, les parcours décrits sont ceux de gens ordinaires. D’un côté, voici Machine, elle est camionneuse pendant 20 ans, elle transitionne, et voilà maintenant elle est toujours camionneuse. Mais elle est contente. De l’autre vous avez Caroline Eliacheff, qui vous raconte que votre enfant est sur Instagram en train de parler avec des activistes qui lui disent de se faire couper toute sorte de petits bouts de son corps et que ça va être la fin de la civilisation. Forcément, l’un des deux sujets est plus vendeur.
Entretien réalisé le 19 janvier 2023